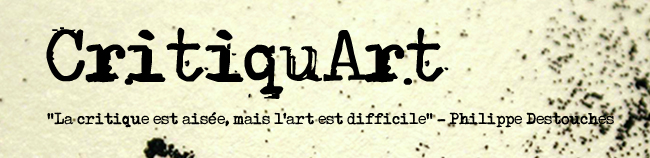skip to main |
skip to sidebar
 Ils ont désormais quitté nos écrans ces personnages, ma foi si superficiels, dont je ne pouvais me séparer chaque semaine, et ce, depuis quatre ans. En effet, c’est hier, 21 h, sur les ondes du réseau américain FOX, que la célèbre télésérie The O.C. diffusait ses soixante dernières minutes.
Ils ont désormais quitté nos écrans ces personnages, ma foi si superficiels, dont je ne pouvais me séparer chaque semaine, et ce, depuis quatre ans. En effet, c’est hier, 21 h, sur les ondes du réseau américain FOX, que la célèbre télésérie The O.C. diffusait ses soixante dernières minutes.
Faut croire que son créateur, Josh Schwartz, avait une dent contre le réseau alors que le personnage de Summer (Rachel Bilson) critiquait dans une scène : « These teen TV shows never end! ».
L’épisode n’a été que prévisible. Il était également beaucoup trop chargé : mariages, déménagement, nouvelle entrée sur le marché du travail et tout le tralala. Schwartz n’a laissé aucune place à l’imaginaire du téléspectateur : il lui a tout balancé, et ce, en moins de dix minutes.
Que de soulagement toutefois, au cours de la dernière scène de l’émission, alors que le plus beau plan de la série a été réinsérer au montage, plan tourné lors de la première saison, alors que la silhouette de Marissa (Mischa Barton) se dessine à contre-jour d'un couché de soleil sublime. Schwartz n’avait d’autre choix que de ramener l’âme de ce personnage au cours de ce dernier épisode : après tout, la série lui doit bien son succès.
R.I.P. Orange County… and thank God we still have One Tree Hill!
 Siri Hustvedt a longtemps vécu dans l’ombre de son époux, le célèbre auteur Paul Auster. Son quatrième roman, Tout ce que j’aimais, devrait la dissocier de l’image de son autre moitié, pour enfin réclamer une notoriété qui lui est propre.
Siri Hustvedt a longtemps vécu dans l’ombre de son époux, le célèbre auteur Paul Auster. Son quatrième roman, Tout ce que j’aimais, devrait la dissocier de l’image de son autre moitié, pour enfin réclamer une notoriété qui lui est propre.
Développé sur une trentaine d’années, soit de 1970 à 2000, le récit met en scène Leo, un professeur d’histoire de l’art, sa femme Erica, un professeur d’anglais, Bill, un artiste peintre ainsi que Violet, une écrivaine, à la fois muse et compagne de ce dernier. Habitant dans un quartier huppé de New York, les deux couples d’artistes évoluent à travers leurs passions, le succès, l’art d’être parent, le deuil, le désir, le mensonge ainsi que la vieillesse.
Tout ce que j’aimais évoque le cycle d’une vie dont le fondement repose essentiellement sur un protagoniste plus ou moins métaphorique : l’art. En effet, l’histoire suit son cours en parallèle à l’évolution de l’œuvre du personnage de Bill. Le décès de ce dernier représente un pilier fondamental alors que le rythme du récit est drastiquement brisé et que la psychologie des personnages se trouve déstabilisée.
Il s’agit d’un lourd roman au cours duquel d’élégantes descriptions et mises en situation nous donnent l’impression de mener vers le néant, outre nourrir notre amour pour l’histoire de l’art. C’est au moment de la perte du petit Matthew, le fils de Leo et d’Erica, que l’on réalise la subtilité ainsi que la finesse de l’écriture d’Hustvedt; à quel point le déroulement des péripéties est brillamment orchestré.
Les portraits qu’elle dresse sont d’une importante complexité. La recherche et l’analyse susceptibles à la conception de l’œuvre reflètent un travail extrêmement pointu. L’auteure réussit à créer un environnement social si près de la perfection que l’on baigne constamment dans l’angoisse de chacun de ses acteurs, et ce, jusqu'à la 453e page.
Le roman d’Hustvedt laisse également beaucoup de place au lecteur. Les tableaux que l’écrivaine peint de l’état des personnages nous portent à réfléchir sur des thèmes traversés par le narrateur, Leo, soient de l’amitié à l’envie, puis de la perte à la trahison pour enfin accéder à l’espoir.
Tout ce que j’aimais parvient, à travers le portrait d’un être à la fois solitaire et généreux, à nous faire reconsidérer notre art d’aimer, notre art de vivre.
 C’est au cours de la semaine du 8 au 17 février que le légendaire Café Campus célébrait son 40e anniversaire. Ses adeptes étaient au rendez-vous et ses invités ne se sont certainement pas fait prier.
C’est au cours de la semaine du 8 au 17 février que le légendaire Café Campus célébrait son 40e anniversaire. Ses adeptes étaient au rendez-vous et ses invités ne se sont certainement pas fait prier.
Avec Marco Calliari comme porte-parole, le Café Campus respectait ses soirées thématiques avec en prestation des artistes qui ont connu, jadis, les veillées endiablées de la place, soient Planet Smashers, Raoul Duguay, Fred Fortin, Plaster, Xavier Caféïne, Malajube et bien d’autres.
Ayant eu ma part de soirées débauchées à l’intérieur de ses murs moisis par la sueur des corps dansants sur un plancher souillé par la bière, je me devais de souhaiter bonne fête au Campus. J’ai ainsi été voir le spectacle à guichet fermé de Xavier Caféïne et Malajube.
Caféïne, fidèle à sa réputation de bête de scène, n’a pas fait de déçus. Malgré une extinction de voix, il a su faire lever la foule. Ses déhanchements excentriques vibraient au rythme électrisant de son ensemble musical. La chimie ardente présente au sein du chanteur et de ses musiciens était contagieuse. Avec OK!, Montréal (cette ville) ainsi que Gisèle, Caféïne et ses acolytes savaient maintenir l’énergie. Toutefois, le public a été avare en longévité d’applaudissements et un rappel provoqué par un membre de la troupe Caféïne s’est avéré plutôt pathétique.
C’était une cinquième rencontre en moins d’un an pour Malajube et moi et notre histoire tire désormais sur sa fin. Faut croire que le succès monte définitivement à la tête de ces cinq musiciens, tout aussi déconnectés que présomptueux, qui n’ont dorénavant plus de raisons de prôner les valeurs de la scène musicale underground.
Une fois de plus, nous nous trouvions dans l’impossibilité de bien distinguer la voix du chanteur. Le public pouvait l’accompagner que s’il connaissait sur le bout des doigts le répertoire lyrique du groupe. La prétention de Mineau a définitivement trahie l’authenticité de son talent. Les arrangements musicaux lui ont toutefois rendu justice. À vrai dire, c’est en détournant mon regard de la scène que j’arrivais à pénétrer dans la transe ravageuse que sait si bien provoquer Malajube.
Le groupe a également prouvé son goût pour le risque. La formation a lancé le bal avec l’enchanteresse Monogamie. Ils ont ensuite enchaîné avec Montréal -40 ˚C puis Pâte Filo. Malgré cette sélection audacieuse, Malajube a su maintenir ses adeptes dans son univers musical chaotique.
 Le nouvel enfant chéri de l’industrie musicale québécoise, Dumas, a récemment lancé son troisième album, Fixer le temps. Presque quatre ans après l’envoûtant Le cours des jours, il nous présente enfin du nouveau matériel, un projet qui n’arrive malheureusement pas à la hauteur du précédent album.
Le nouvel enfant chéri de l’industrie musicale québécoise, Dumas, a récemment lancé son troisième album, Fixer le temps. Presque quatre ans après l’envoûtant Le cours des jours, il nous présente enfin du nouveau matériel, un projet qui n’arrive malheureusement pas à la hauteur du précédent album.
En effet, le guitariste au rythme mélancolique reste fidèle à son image de romantique timide et blessé ainsi qu’à ses mélodies simples et harmonieuses. Malgré l’acquit d’une grande maturité, Dumas ne réussit pas à se réinventer. Au fil d’un répertoire éprouvant une faible défaillance en termes de variété, on le sent plus en confiance, mais plusieurs notes restent prévisibles.
C’est à ma grande tristesse qu’il laisse tomber les belles métaphores sensuelles et nostalgiques pour des textes beaucoup moins recherchés. Il réussit toutefois à nous séduire avec De station en station ainsi que Les secrets, des pièces joliment orchestrées « à la Dumas », une recette dans laquelle il marie finement le plus bel instrument de son assortiment musical, sa voix, avec la délicatesse de sa guitare.
Après nous avoir fait baigner dans l’univers cyclique du Cours des jours, l’artiste continue de nous livrer son obsession spatio-temporelle. Ce dernier nous présente ainsi La vie qui bat, La ville s’éveille, Au gré des saisons (le premier simple), De station en station, des pièces qui reflètent son esprit bohème et lyrique.
Est-ce que Steve Dumas réussit à fixer le temps? Il s’agit d’une lutte acharnée au cours de laquelle il devra vaincre ses démons du présent afin de retrouver ses racines du passé pour ainsi se renouveler dans l’avenir.
 Xavier Caféïne présente enfin son projet solo, Gisèle, un premier disque se voulant une critique sociale obscure. Fidèle à la tendance des jeunes artistes émergents de la belle province, Caféïne s’inspire de la métropole pour évoquer son mal d’amour. Malajube a utilisé la métaphore avec Montréal -40 °C. De son côté, Xavier Caféïne le fait avec Montréal (cette ville), son premier simple, une chanson au rythme accrocheur nettement représentative de la bonne pop rock québécoise.
Xavier Caféïne présente enfin son projet solo, Gisèle, un premier disque se voulant une critique sociale obscure. Fidèle à la tendance des jeunes artistes émergents de la belle province, Caféïne s’inspire de la métropole pour évoquer son mal d’amour. Malajube a utilisé la métaphore avec Montréal -40 °C. De son côté, Xavier Caféïne le fait avec Montréal (cette ville), son premier simple, une chanson au rythme accrocheur nettement représentative de la bonne pop rock québécoise.
Au fil de son registre, Caféïne cri haine et amour à celle dont il a offert son cœur, ridiculise la bourgeoisie contemporaine soi disant environnementaliste et blâme notre société de consommation pro-américaine. Il prêche son discours derrière son alter ego : l’oiseau noir. En effet, il s’agit d’un Xavier Caféïne beaucoup plus engagé et malgré la facilite de certains textes, réussit à nous porter avec des mélodies poignantes.
Après avoir fait une première tentative au sein du groupe Caféïne à la fin des années 90, puis une seconde en tant que leader de la formation anglophone Poxy, l’artiste aux penchants excentriques prend avec assurance les commandes de ce premier album. Sur ce dernier, il prouve sa polyvalence musicale en jouant la majorité des instruments. Avec Gisèle, Caféïne nous convainc qu’il est un artiste indépendant qui s’auto-suffit amplement.
 Sorti tout droit d’une meute australienne, le trio Wolfmother vient ravager la scène musicale américaine en criant gare au loup. Les moutons qui figurent au sommet des palmarès et qui nous cassent les oreilles sur les ondes radiophoniques et télévisuelles ont de quoi bêler.
Sorti tout droit d’une meute australienne, le trio Wolfmother vient ravager la scène musicale américaine en criant gare au loup. Les moutons qui figurent au sommet des palmarès et qui nous cassent les oreilles sur les ondes radiophoniques et télévisuelles ont de quoi bêler.
Étais-je l’unique nostalgique? La dernière vague de bon rock indie aux mélodies ravageuses de guitares date de 2001-2002. Cette dernière, nous l’avons connue avec The White Stripes, The Hives, The Strokes et tous ces groupes qui sont restés fidèles à l’article The, inspirés du bon vieux punk british de la fin des années 70.
Cinq ans plus tard, la tendance est au mouvement récemment baptisé emo (du terme anglais emotion). Ce dernier vante la montée du punk rock (ou plutôt pop punk), mais ne réussit qu’à pleurer ses misérables sentiments avec des riffs de guitare tout aussi similaires qu’ennuyeux. Pensons entre autres à 30 Seconds to Mars, Panic! At the Disco et My Chemical Romance. Même Fall Out Boy (malgré tout le respect que j’éprouve à l’égard de Pete Wentz) et le groupe canadien Three Days Grace se sont joints au troupeau en arborant la marque de commerce du courant : le fameux eye liner.
Heureusement, Wolfmother, avec son premier album éponyme, sait nous garder fervent du punk rock contemporain, celui du nouveau millénaire. Et détrompez-vous, ce n’est pas seulement la pochette qui fait toute la beauté de cette nouvelle formation.
La voix criarde d’Andrew Stockdale nous rappelle celle du vénérable Jack White. Les premières notes de The apple tree sauront vous convaincre. Même les riffs du refrain de Tales nous font penser à Ball and biscuit. Toutefois, c’est la chimie provoquée par une guitare ravageuse et une batterie impérative qui oriente le fil conducteur de chaque mélodie. Les changements de tons musicaux sont d’une imprévisibilité prête à vous déstabiliser. L’absence de la voix à la fin de White unicorn nous fait découvrir la démence d’un synthétiseur qui nous transcende pour toute la durée de la trame sonore. Enfin, l’audacieux emploi d’un instrument à vent dans Witchcraft vous ensorcellera.
C’est avec brio que Wolfmother se présente au devant d’une relève qui nous fait revivre le punk rock criard et poignant restant fidèle à ses racines garage. Ce nouveau son vous fera renier votre poste de bon berger pour ainsi laisser dévorer vos petits protégés. Ou peut-être rejoindrez-vous le cercle des louveteaux...
 Ils ont désormais quitté nos écrans ces personnages, ma foi si superficiels, dont je ne pouvais me séparer chaque semaine, et ce, depuis quatre ans. En effet, c’est hier, 21 h, sur les ondes du réseau américain FOX, que la célèbre télésérie The O.C. diffusait ses soixante dernières minutes.
Ils ont désormais quitté nos écrans ces personnages, ma foi si superficiels, dont je ne pouvais me séparer chaque semaine, et ce, depuis quatre ans. En effet, c’est hier, 21 h, sur les ondes du réseau américain FOX, que la célèbre télésérie The O.C. diffusait ses soixante dernières minutes.